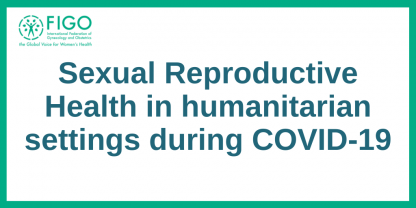COVID-19 : les fermetures d'usines entraînent une augmentation de la violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles
La pandémie mondiale de COVID-19, qui se propage sans discernement, a emporté des êtres chers avant l'heure : des villes et des quartiers autrefois animés sont aujourd'hui "verrouillés".

Alors que la propagation du COVID-19 se fait sans discrimination, des preuves de plus en plus nombreuses ont révélé que le COVID-19 a encore aggravé les inégalités existantes, exposant les femmes et les filles déjà marginalisées, qui ont souvent un accès plus limité au pouvoir politique et économique, à un risque plus élevé, non seulement face au coronavirus, mais aussi face aux conséquences directes et indirectes de l'enfermement.
L'engagement de laFIGO et de ses 132 sociétés membres nationales à promouvoir la santé et les droits des femmes précède la pandémie de COVID-19, mais les deux sont explicitement liés. ONU Femmes a signalé une augmentation mondiale des cas de violence domestique et de nouvelles données publiées par l'UNFPA révèlent que pour chaque période de trois mois pendant laquelle le confinement se poursuit, on s'attend à 15 millions de cas supplémentaires de violence fondée sur le genre, 13 millions de femmes ne seront pas en mesure d'accéder à des contraceptifs modernes et on estime à 325 000 le nombre de grossesses non désirées.
Ces chiffres constituent une lecture poignante et sont encore aggravés par le fait que les progrès vers l'objectif 3 du Programme de développement durable à l'horizon 2030 (ODD), qui comprend la réduction des décès maternels à l'échelle mondiale, sont très en retard par rapport à la cible fixée, et il s'agissait d'une mise à jour avant l'apparition de la pandémie de COVID-19.
Dans le monde, on estime que 303 000 femmes sont mortes de complications liées à la grossesse et à l'accouchement en 2015, et les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses représentent 13 % des décès maternels dans le monde. La quasi-totalité de ces décès auraient pu être évités et se sont produits dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
L'augmentation de la violence à l'égard des femmes et des filles a un lien direct avec les grossesses non désirées, ce qui accroît les risques de décès maternels, si l'accès à un avortement sûr n'est pas possible. C'est pourquoi, plus que jamais, le projet de la FIGO en faveur de l'avortement médical isé est encore plus pertinent et a un rôle clé à jouer pour s'assurer que les services d'avortement médicalisé sont offerts dans toute la mesure permise par la loi dans chaque pays.
Le professeur Robert J. I Leke, président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Cameroun (SOGOC) , s'exprime à ce sujet :
"La pandémie est susceptible d'accroître les violences domestiques et sexuelles entraînant des viols et des grossesses non désirées et une augmentation du taux d'avortement par la suite, [et] nos lois sur l'avortement sont encore restrictives au Cameroun"
En outre, le Dr Mwansa Lubeya, gynécologue-obstétricienne en Zambie, a fait part de ses inquiétudes quant à l'application des mesures de confinement, qui pourrait donner lieu à des abus de pouvoir (comme cela a été récemment rapporté au Rwanda).
"Les forces de l'ordre peuvent violer des jeunes femmes pendant les périodes de confinement et de réduction de l'affluence, c'est-à-dire lorsque les femmes sont attrapées et violées en guise de punition, ce qui peut conduire à des grossesses non désirées
Le Dr Lubeya souligne qu'en raison de la pandémie de COVID-19 :
les médecins et autres praticiens de la santé se sont tournés vers la lutte contre le COVID-19 et l'avortement médicalisé n'est plus considéré comme une urgence, même s'il l'est
Le Dr Musonda Makasa, gynécologue-obstétricien à l'hôpital universitaire de Zambie, ajoute :
"L'accès est essentiel pour éviter les avortements clandestins et les mauvaises séquelles sanitaires qui y sont associées. Le ministère [de la santé] peut donner des conseils sur la manière dont les hôpitaux peuvent réorganiser le flux de patients et le triage sans désavantager d'autres conditions."
En Amérique latine, des pays ont également adopté des mesures de verrouillage et des gouvernements tels que le Panama et le Pérou ont également eu recours à une politique de verrouillage en fonction du sexe, ce qui a également donné lieu à des allégations de mauvais traitements de la part de la communauté transgenre.
Le Dr Ruth De León, gynécologue-obstétricienne, responsable de la recherche au département de la santé sexuelle et génésique de l'Institut Gorgas Memorial pour les études de santé, au Panama, souligne que "le Panama vit aujourd'hui une politique d'enfermement total et obligatoire :
"Le Panama vit aujourd'hui une quarantaine totale et obligatoire, qui n'autorise qu'une circulation maximale de deux heures par jour, trois jours par semaine, en fonction du sexe et du dernier numéro du document d'identité personnel. Les lundi, mercredi et vendredi, les femmes peuvent se mobiliser ; les mardi, jeudi et samedi, les hommes. Le dimanche est un jour d'immobilité absolue"
Comme au Cameroun et en Zambie, l'avortement au Panama est régi par un cadre juridique restrictif, concernant l'accès à l'avortement en cas de viol. Il est nécessaire que le crime soit signalé à l'autorité compétente et que l'avortement soit pratiqué dans les deux premiers mois de la grossesse - 8 semaines.
Le principal défi est que la pandémie de COVID-19 n'affecte pas les procédures régulières qui permettraient aux femmes d'accéder à un avortement légal et sûr, comme celles liées à la jurisprudence nécessaire pour vérifier et certifier un cas de violence sexuelle et l'approbation des cas d'avortement thérapeutique.
Le Dr De León ajoute :
"Le ministère de la santé doit veiller à ce que les processus visant à rendre accessibles les services d'avortement légaux et sûrs dans le pays ne soient pas affectés par les nouvelles règles/mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ils doivent garantir qu'il y a des espaces pour effectuer les procédures médicales stipulées pour les soins des cas d'avortement"
Entre-temps, la Société panaméenne de gynécologie et d'obstétrique (SPOG), membre de l'association des gynécologues-obstétriciens du Dr De León, prend des mesures pour s'assurer que l'impact des fermetures d'établissements COVID-19 sur les femmes et les jeunes filles est mis en évidence et pris en compte :
des communications ont été créées pour établir un lien entre l'environnement de la pandémie, les risques de violence domestique et sexuelle et la manière de procéder, étant donné qu'il s'agit de la principale cause d'avortement clandestin, en prêtant attention aux signes d'alerte de l'urgence obstétrique. Ces communications ont été diffusées sur nos réseaux sociaux. Notre objectif est de réduire la mortalité maternelle causée par les avortements à risque"
On estime à 25 millions le nombre d'avortements pratiqués dans des conditions dangereuses chaque année, dont 97 % dans les pays à faible revenu. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'accès à l'avortement sans risque est un soin de santé essentiel et urgent, mais en 2017, 42 % des femmes en âge de procréer vivaient dans les 125 pays où l'avortement est fortement limité (interdit ou autorisé uniquement pour sauver la vie d'une femme ou d'une fille ou protéger sa santé).
De nombreux gynécologues-obstétriciens et professionnels de la santé ont souligné que le manque de clarté quant aux circonstances dans lesquelles un avortement peut être pratiqué, par exemple ce que signifient exactement les mots "sauver la vie ou la santé d'une femme ou d'une fille", laisse un vide dangereux. Le manque de clarté des lois sur l'avortement est également renforcé par l'absence de directives nationales sur l'avortement, ce qui crée et entretient un environnement hostile pour les gynécologues-obstétriciens, qui craignent constamment des représailles et l'emprisonnement s'ils pratiquent un avortement sûr. Cet environnement hostile favorise la stigmatisation et le silence des femmes et des jeunes filles qui cherchent à avorter dans de bonnes conditions, ce qui accroît le risque d'avortement à risque et de décès maternel.
Face à l'escalade de la pandémie de COVID-19, il est essentiel que davantage de gouvernements investissent d'urgence dans des ressources et des services destinés à protéger le droit des femmes et des jeunes filles à vivre à l'abri de la violence.
En outre, les soins de santé génésique des femmes et des jeunes filles doivent être prioritaires, ce qui implique de garantir l'accès à la contraception et de mettre en œuvre des mesures telles que la télémédecine pour pratiquer des avortements sans risque. Ces services sont déjà en place dans certains pays, comme l'Australie avant la conférence COVID-19, et ont été récemment adoptés par des pays comme l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, apportant une solution indispensable pour éviter les avortements non médicalisés et les décès maternels.